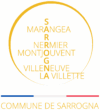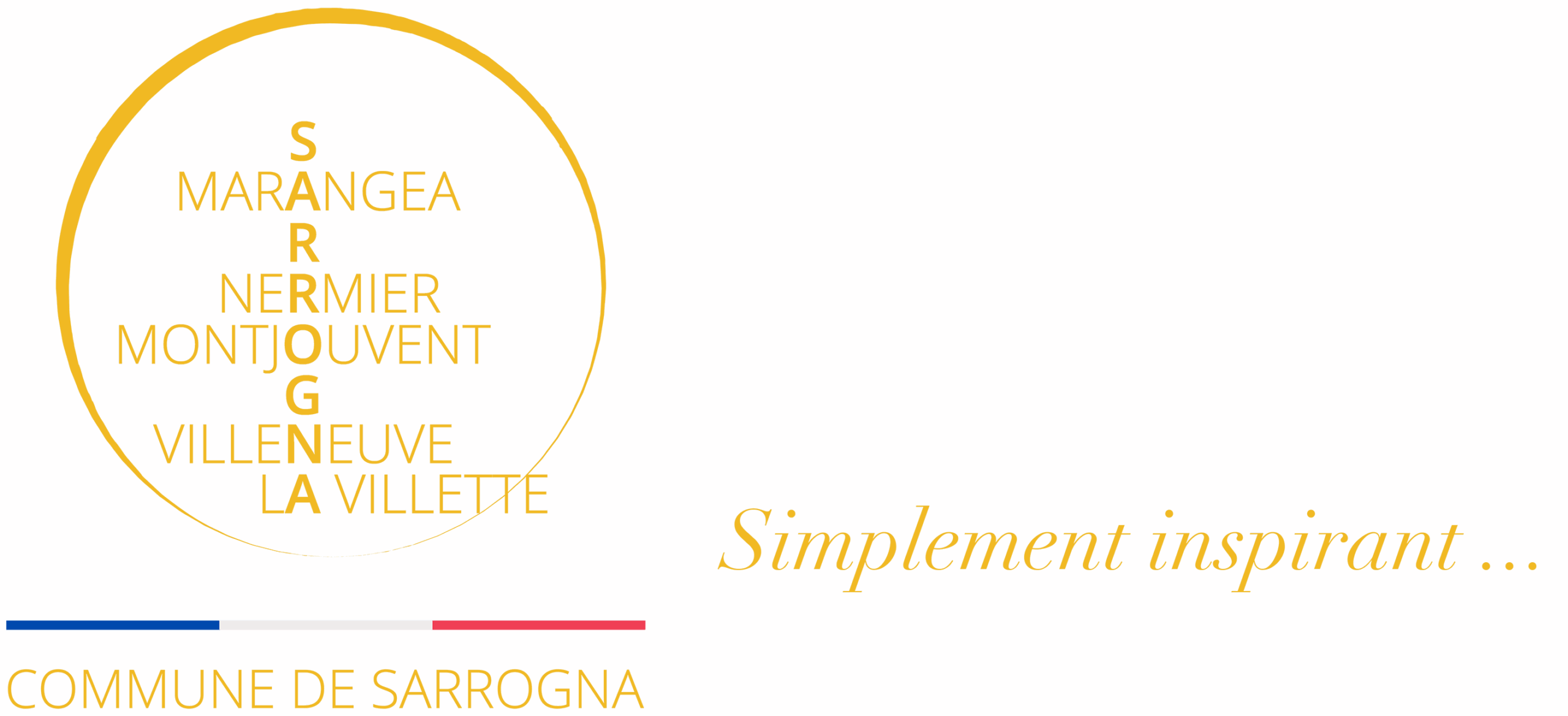Située dans le département du Jura, la commune de Sarrogna présente la particularité d’occuper une grande superficie: 1953 hectares dont environ 700 ha de forêts.
Son territoire se déploie au cœur de la Petite Montagne à quelques kilomètres au sud d’Orgelet (entre 5 et 8 km selon les hameaux) et est proche du parc naturel régional du Haut-Jura, à environ 6 km.
Il résulte de regroupements communaux qui ont débuté dès 1822 (regroupement de Villeneuve et La Villette avec Sarrogna) puis en 1971 de Marangea, Montjouvent et Nermier qui se répartissent entre 480 mètres et 607 mètres d’altitude.
Entourée par les communes de Fétigny, Écrille et Onoz, Sarrogna est situé à 23 km au Sud-Est de Lons-le-Saunier, la plus grande ville aux alentours.
Ses habitants sont appelés les Sarronides et sa population évolue régulièrement à chacun des recensements : 146 habitants en 1990, 186 en 1999, 202 habitants en 2004, 219 habitants en 2009, 225 en 2011, 232 en 2012.
Le rattachement à la communauté de communes Terre d’Émeraude a permis d’accroître et de rajeunir la population grâce aux nombreux services qui sont proposés pour la scolarisation (accueil péri et extra scolaire, restauration, réseau assistantes maternelles et parents), pour les adultes (maisons des services, médiathèque) et pour les personnes âgées avec le foyer logement.
Sarrogna
Sarrogna, Sarrumniacurn, Sarruniacum,Sarroniacum, Saroniacus, Sarregny
Dans un val accidenté que ferment à l’est et à l’ouest deux chaines parrallèles de montagnes d’un aspect sévère et silencieux, se cachent les trois villages de Sarrogna, Villeneuve et la Villette. Deux étymologies se présentent pour expliquer le nom de Sarrogna: celle de Saronia, surnom de Diane chasseresse, et celle de Saronis, chêne, d’où vint la qualification de Saronides, donnée aux druides pour exprimer le voeu qu’ils faisaient de passer leur vie parmi les chênes les plus vieux et les plus cassés. Aucune contrée n’est plus mythologique dans le Jura que celle qui s’étend d’Orgelet à Arinthod. Les monuments celtiques y sont aussi nombreux que les croyances populaires qui ont survécu aux vieilles superstitions gauloises. Un ancien chemin, communiquant de la ville d’Héria et de Mauriana à Arinthod, venait aboutir à Sarrogna où elle a conservé la dénomination de Vie Blanche. Le chemin d’Orgelet à Arinthod et à Isernore traversait aussi ce village et passait au pied du chateau de la Villette. Il est désigné sous le titre de via publica dans une donation faite en 1237 par Hugues, fils de Fromond de Dramelay, à la chartreuse de Vaucluse.
Entre le vieux château de Villeneuve et Sarrogna, on remarque des retranchements très importants en terre et pierre, appelés les Forts Sarrazins. Ils consistent en une éminence artificielle de forme circulaire, ayant 40m de diamètre et 4m de hauteur, entourée par un fossé de 7m de largeur et de 2m de profondeur et ressemblent aux mottes de Montmarlon et de Vers-en-Montagne. Nous croyons voir dans ces travaux de petits oppida dans lesquels les populations gauloises cherchaient un refuge en temps de guerre. A côté, sont plusieurs salles voûtées qui ont conservé le nom de Vieux-Fours.
Dans le lieu dit au Tour, entre Sarrogna et Chambéria, on trouve une grande quantité de tuileaux à rebords, de laves calcinées et de débris de constructions romaines. Dans le voisinage et surtout dans le lieu dit à la Tepinière, on rencontre une multitude de tombeaux en dalles qui renferment des squelettes humains ayant la tête tournée au nord. Ils ne contiennent point d’armes, mais on y a recueilli plusieurs monnaies impériales. Un tumulus de 15m de diamètre et de 2m de hauteur se voit au sud-est du village. On en compte 3 autres d’une dimension moindre, épars sur différents points du territoire. Sur la montagne de Beffrand, entre Sarrogna et Nermier, au milieu de la forêt de Courailloux, s’élevaient deux fortins, l’un dit le grand-fort et l’autre le petit-fort. On en reconnait encore les vestiges près de la Fontaine au chevalier. A quelle date remontaient-ils ? On l’ignore.
Le premier titre qui mentionne Sarrogna est une charte par laquelle Anséric, archevêque de Besançon, donna l’autel de ce village à l’abbaye de Saint Claude (1117 à 1134). Villeneuve, Villa nova, figure dans plusieurs documents du XIIe siècle. La Villette, Villula dont le château bâti suit une éminence qui s’avançait comme un promontoire entre 2 vallées, protégeait la route d’Orgelet à Arinthod, a dû exister à l’époque romaine et se reformer dès les premiers temps de la féodalité.
Seigneurie de Villeneuve : Elle comprenait le village de ce nom, la moitié de Sarrogna et des meix épars à Faverges, la Villette et les lieux environnants. Le seigneur n’avait sur ses sujets que la justice moyenne et basse, la haute justice appartenant au seigneur d’Orgelet. De ce fief dépendaient un château-fort, 4 forêts banales, des corvées, des lods sur les mutations d’immeubles, le tiers des dîmes et des redevances en argent, en grains , en poules, et en chevreaux. Les habitants avaient le droit de couper du bois pour leur chauffage dans les forêts de la seigneurie et pouvaient même y opérer des défrichements, à charge de payer un droit de tâche, fixé au dixième des droits des grains récoltés.
Seigneurs : Jean, sire de Viremont, est le premier seigneur connu de Villeneuve. Il vivait en 1268, et eut pour successeur Etienne de Viremont, son fils. Poly, fils d’Etienne de Viremont, écuyer, se qualifiait de seigneur de Villeneuve en 1357. Philippe son fils, écuyer, filt hommage de son fief, en 1390, au seigneur d’Orgelet, et légua sa fortune à Claudine de Montrichard, son épouse, qui se remaria en 1423 à Pierre de Quingey. Cette dame vendit Villeneuve, quelques années après, à Claude de la Baume, comte de Montrevel, Vallefin, Présilly, Beaulieu, Pellapucin, Beauregard, qui transmit ce domaine à ses successeurs. Claude de la Baume, baron de Mont-Saint-Sorlin, maréchal de Bourgogne, le vendit sous faculté de rachat, en 1533, à Jean Lallemand, baron de Bouclans, qui subrogea à ses droits le 31 août 1538, Jean de Vaudrey.
Après la mort du maréchal de la Baume, Claude de la Baume, archevêque de Besançon, et François de la Baume ses fils, chargèrent Claude de la Villette de rembourser, en leur nom, le baron de Bouclans ou M de Vaudrey, et de reprendre possession de Villeneuve (1557). Antoine, fils de françois de la Baume, en fit hommage en 1583 au seigneur d’Orgelet et, peu d’années après, il vendit cette terre à Benoît Charreton, seigneur de Chassey. La famille Grivel de Perrigny la racheta des enfants de cet acquéreur. Claude-François et Henri-Gaspard de Grivel, seigneurs de Perrigny, l’aliénèrent, le 30 décembre 1715 à Eléonor-Bénigne-François du Pasquier, qui l’unit définitivement à sa seigneurie de la Villette.
Château : le château de Villeneuve occupait un mamelon et était défendu par une enceinte de murailles et des fossés. Il en reste encore des vestiges dans le lieu dit au Vieux-Château. Cette forteresse, ruinée par les troupes de Louis XI en 1479, ainsi que le constatent divers dénombrements, n’a pas été rétablie.
Seigneurie de Sarrogna : Le territoire se divisait en deux parties à peu près égales : l’une dépendait de la seigneurie de Villeneuve et l’autre appartenait en moyenne et basse justice aux chartreux de Vaucluse. Cette portion avait été donnée aux chartreux par Ponce 1er de Cuisel, ce qui n’empêcha pas une foule de seigneurs de s’en disputer la possession. Ce n’est qu’après des luttes, des enlèvements d’hommes à main armée et des excommunications, que Perrin Recordelle de Dompierre et Gérard de Rosay (1205), Hugues et Simon, fils de Humbert de Nancuise (1213), Guillaume de Varey, chevalier (1228), Hugues de Costarel, chevalier (1231), Guillaume de Rosay, Pierre, son fils, et Thiébaud de Fétigny (1233), Hugues, fils de Fromond de Dramelay (1237), Fromond de Dramelay, sire de Présilly (1252), et Provin, fils de Guillaume d’Ugna (1283), consentirent à vendre ou à donner à la chartreuse leurs prétentions sur Sarrogna. Le plus violent de ces vassaux fut Guillaume de Varey, qui ne craignit pas de surprendre Étienne, frère du prieur de Vaucluse, et de ne le rendre à la liberté que moyennant une rançon de 300 sols (1237). La haute justice appartenait au seigneur d’Orgelet.
Seigneurie de la Villette-lez-Fétigny : elle comprenait le village de ce nom et une partie de Fétigny en toute justice, haute, moyenne et basse. Le seigneur avait l’impôt des quatre cas, la propriété des communaux, la police des chemins, les épaves, les lods sur les mutations d’immeubles, les langues des grosses bêtes tuées dans l’étendue de la seigneurie, environ 600 journaux de bois banaux, des terres, des prés, des cens en argent et en grains, et des portions de dîmes sur la Villette, Fétigny, Légna, Néglia, Montadroit et Chambéria.
Les sujets devaient faire le guet et garde et la revue d’armes au château et deux corvées par an. Chaque ménage était tenu de donner au seigneur, annuellement, un fromage, une poule, un chevreau, une redevance appelée la Levée, une autre dite la Guette, et enfin de porter au château, le dimanche après Noël, un pain blanc et un jambon de porc. Le signe patibulaire, pour l’exécution des criminels, était dans le lieu dit au Molard de la Corbe.
Seigneurs : le premier seigneur connu de la Villette est Étienne de Beaufort, sire de Beaulieu, qui eut pour fils et héritier Guillaume de Beaufort, chevalier, vivant en 1362.
Antoine, fils de Philippe de Beaufort, écuyer, sire de Beaulieu, vendit, en 1433, la terre de la Villette à Bernard de Gières, maître d’hôtel de Louis de Chalon-Arlay. Jean de Gières, fils de cet acquéreur, n’ayant pas eu d’enfants d’Antoinette de Vaudrey, son épouse, laissa sa fortune à Louis de Verges, Aubine de Boyon, Philibert et Claude de Mipoix, qui aliénèrent la Villette en faveur d’Eberard de Mipoix, seigneur d’Aubigny (1514). Ce dernier, peu satisfait de son acquisition, subrogea à ses droits Philibert Guigonard, écuyer (1515). Perrin Morel, écuyer, acheta ce domaine en 1564, et prit le nom de la Villette. Philibert de Chissey, écuyer, seigneur de Chalain, ayant épousé Mlle de la Villette, devint propriétaire de la seigneurie de ce nom en 1584 ; mais, à la suite d’un procès auquel donna lieu une substitution contenue au testament de Perrin Morel. Il fut dépossédé par Gérard de la Villette, dit de Morel (1616), seigneur de Virechâtel. Jeanne-Bénigne de la Villette, dite de Morel, succéda à Gérard de la Villette, son père, et s’allia à Humbert de Canoz, dit du Pasquier, qui fit faire une reconnaissance des droits seigneuriaux de sa terre en 1631.
Eléonor-Bénigne-François du Pasquier, fils d’Humbert, fournit, en 1716, le dénombrement de son fief de la Villette au prince d’lsenghien. Il eut pour fils Joseph-Antoine-Daniel du Pasquier de Maisod, seigneur de la Villette, Fétigny, Montadroit, etc. Mlle Thérèse-Eléonore du Pasquier, fille de ce dernier, s’allia à Louis-Joseph-Alexandre, marquis de Rose, officier d’infanterie au régiment de Bourbon, dont naquit, le 8 novembre 1772 au château de la Villette, Louis-Joseph-Alexandre, marquis de Rose, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Saint-Louis, décoré de l’ordre du Phénix d’Hohenloë et de Saint-Ferdinand d’Espagne. La marquise de la Villette ayant émigré avec son fils, ne rentra en France que sous l’empire et mourut à Dammartin (Haute-Marne) en 1807. Ses biens avaient été confisqués et vendus nationalement, les 8 mars et 5 août 1798, à M. Claude-Joseph de Rose, qui les rétrocéda, le 17 janvier 1808, au marquis de Rose fils. Ce dernier vendit, en 1818, le domaine utile de la Villette à M. Jacquin. Le château est habité actuellement par la veuve de cet acquéreur.
Château : Le château de la Villette occupe l’extrémité d’un plateau qui s’avance en pointe dans la profonde et étroite vallée du Biserand. Il se compose d’une cour d’honneur emplantée de beaux et très anciens tilleuls, dans laquelle on pénètre par une grande porte ouverte entre un jardin et un bâtiment d’hébergeage ; d’une seconde porte donnant accès dans la cour intérieure, percée dans un mur d’enceinte de 15m de hauteur et surmontée d’un balcon avec mâchicoulis ; d’un donjon carré à droite de cette porte et d’une salle des gardes avec tour circulaire à gauche ; d’un corps de logis attenant au donjon et renfermant au premier étage la chapelle seigneuriale, qui était dédiée à saint François de Sales, et le cabinet des archives, fermé par une porte en fer ; et enfin de la maison-forte, au fond de la cour, flanquée au nord-ouest d’une tour carrée ; une tour octogonale renferme l’escalier qui conduit à la chapelle. Un bâtiment, bordant la cour d’honneur, a été ajouté depuis 1789. Ce château était très important ; il est en grande partie du style ogival, mais il manque de symétrie. Les réparations exécutées en 1602 et 1682 ont détruit l’harmonie de cet édifice. Jean de Gières embrassa avec ardeur, en 1477, la cause de Louis XI, et reçut dans la forteresse une garnison française. Le 25 septembre 1639, le marquis de Villeroy, après la prise du château de Virechâtel, envoya des troupes pour s’emparer de celui de la Villette. Les assiégeants s’en rendirent maîtres malgré une vigoureuse résistance et l’incendièrent. Ils y brûlèrent pour plus de 20.000 fr. de grains. Ce château a presque toujours été habité par les seigneurs qui l’ont possédé.
Bourg : un bourg, clos de murs et de fossés et habité par plusieurs familles de gentilshommes et par des bourgeois, était attenant au château. Il fut détruit en 1639. Son emplacement n’est plus recouvert que par un modeste village.
Maladrerie : près du bourg de la Villette était un hospice pour les lépreux, qui s’élevait dans le lieu dit à la Malatière. En temps de peste, les malades étaient relégués dans des loges en planches groupées aux Cabornes.
Église : l’église de Sarrogna, située sur le bord oriental de la route, est dédiée à saint Pancrace, martyr, dont on célèbre la fête le 20 mai, et était du patronage de l’abbé de Saint-Claude. Elle se compose d’un clocher, d’une nef, d’un choeur, d’un sanctuaire rectangulaire, d’une chapelle à gauche du choeur et d’une sacristie. Le clocher est couronné par une flèche octogonale peu gracieuse. Cet édifice ne se composait primitivement que du choeur et du sanctuaire; on y a ajouté plus tard une nef, une chapelle, dont la collation appartenait au seigneur de la Villette, et un clocher. On y remarque une jolie statuette de la Vierge, plusieurs reliquaires et une belle châsse renfermant les reliques de saint Justin qui furent apportées de Rome, en 1829, par M. Thurel, prêtre, originaire de Sarrogna.
Pèlerinage de Saint-Pancrace : le pèlerinage à Saint-Pancrace de Sarrogna était célèbre au moyen-âge. Les populations de la Bresse et du Bugey y venaient en foule. La garde de cette vogue appartenait au seigneur de Villeneuve depuis la veille de la fête jusqu’à midi du lendemain, et au seigneur d’Orgelet le jour de la fête depuis midi à minuit. Les officiers de justice de ces seigneurs se tenaient en permanence pour juger les crimes et délits qui se commettaient pendant la durée de la fête.
Biographie
Sarrogna est la patrie de :
- François Clerc, né au hameau de Villeneuve le 3 novembre 1769 et mort en 1847, chevalier de la légion d’honneur, licencié ès-lettres, docteur ès-sciences, professeur de mathématiques spéciales au collège de Saint-Claude, puis à l’école centrale du département de l’Ain et au lycée de Moulins, nommé professeur d’astronomie à la faculté des sciences de Lyon en 1834, auteur de plusieurs ouvrages qui lui ont valu un grand nombre de médailles d’honneur ;
- Constant Jacquin, né en 1808, professeur au collège Saint-Louis, à Paris ;
- François-Daniel Clerc (1772-1854), capitaine d’infanterie, membre de la légion d’honneur.
Nermier
Extrait du Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté de A. ROUSSET
Tome IV (1854)
Nermez, Nennyez, Nerméez
Village de l’arrondissement de Lons-le-Saunier ; canton, perception et bureau de poste d’Orgelet ; paroisse de Sarrogna ; à 2 km de Sarrogna, 5 d’Orgelet, 24 de Lons-le-Saunier en passant par Montaigu et 27 par Revigny. Altitude: 540m.
Le territoire est limité au nord par Plaisia, Écrilles et Marangea, au sud par Sarrogna, à l’est par Onoz et à l’ouest par Montjouvent. Il est traversé par la route départementale n°9, d’Orgelet à Nantua et à Bourg ; par les chemins vicinaux tirant à Montjouvent, à Marangea et à Villeneuve ; par le bief d’Enfer et les ruisseaux de Barésia et de la Fontaine.
Le village est situé au pied septentrional d’une montagne, dans une position assez agréable. Les maisons sont disposées par groupes, construites en pierre et couvertes en tuiles plates, en tuiles creuses ou en chaume. Les massifs d’arbres fruitiers qui les ombragent leur donnent un aspect très pittoresque.
Population : en 1790, 96 habitants ; en 1846,155 ; en 1851, 159, dont 93 hommes et 66 femmes ; population spécifique par km carré, 40 habitants ; 33 maisons ; 37 ménages.
État civil : Les plus anciens registres de l’état civil remontent à 1792. Vocable : saint Pancrace. Paroisse de Sarrogna.
Série communale à la mairie. La série du greffe, déposée aux Archives Départementales a reçu les cotes 3 E 5698 à 5701, 3 E 8117 et 8118, 3E 9873 à 9875 et 3 E 13038. Tables décennales 3 E 1283 à 1291. Microfilmé sous les cotes 5 Mi 789, 5 Mi 1266, 2 Mi 1120, 2 Mi 1843, 5 Mi 16 et 5 Mi 1184. Les jeunes gens émigrent pour être domestiques à Lyon ou à Paris.
Cadastre : exécuté en 1827 : surface territoriale 389h divisés en 1082 parcelles que possèdent 154 propriétaires, dont 103 forains ; surface imposable 383h à savoir : 126h en bois, 122h en terres labourables, 64h en prés, 58h en pâtures, 4h59a en murgers, 3h6a en vergers, 11h 26a en broussailles, 11h 11a en sol et aisances de bâtiments et 41a en murgers ; d’un revenu cadastral de 4616 fr. ; contribution directe en principal 838 fr.
Le sol, en grande partie montagneux, rend trois ou quatre fois la semence et produit du blé, de l’orge, de l’avoine. du maïs, des pommes de terre, du chanvre, beaucoup de fruits et surtout d’excellentes prunes que les habitants font sécher ; du foin, un peu de légumes secs, de carottes fourragères et de fourrages artificiels. On importe le dixième des céréales et le vin. Le revenu réel des propriétés est de 3 fr. 75 pour cent. On élève dans la commune des porcs qu’on engraisse, des bêtes à cornes et des volailles; 30 ruches d’abeilles. L’agriculture y fait des progrès.
On trouve sur le territoire de la marne, d’excellente terre glaise exploitée pour la fabrication de la tuile et de la poterie, de la pierre à chaux ordinaire et hydraulique.
Les habitants, généralement dans l’aisance, fréquentent les marchés d’Orgelet. Leur principale ressource consiste dans l’agriculture et la fabrication de la tuile, de la poterie et de cuillers à pot en bois.
Il y avait un châlet, supprimé en 1852, qui était commun pour Nermier et Marangea, dans lequel on faisait annuellement 5.000 kg de fromages façon Gruyère. On y compte deux établissements de poterie, dont l’un appartient à M. Thurel, maire de la commune, et l’autre à M. Lugand. Douze ouvriers, gagnant en moyenne chacun trois francs par jour, y sont occupés. Les produits, de très bonne qualité, sont exportés dans les arrondissements de Lons-le-Saunier et de Saint-Claude. Leur valeur s’élève chaque année à 8000 fr. au moins. Les habitants font des cuillers à pot en bois pour une valeur annuelle de 2000.fr. et les exportent dans les départements du Jura, de l’Ain et de Saône-et-Loire. Il y a aussi une tuilerie qui fut fondée par les chartreux de Vaucluse au commencement du XVIIIe siècle et dont les produits jouissaient d’une réputation lointaine.
Les patentables sont: 1 maréchal-ferrant, 1 tourneur sur bois et 2 marchands de vaisselle et d’ustensiles en bois. Un moulin existait au bas de Nermier, mais il a été détruit au XVIle siècle.
Biens communaux : une maison commune construite en 1829, qui a coûté 4500 fr.; elle renferme le logement de l’instituteur et la salle d’étude, fréquentée en hiver par 40 garçons et 15 filles. Les filles déjà grandes fréquentent l’école de Sarrogna ; une fontaine avec lavoir et abreuvoir, construite en 1828; un réservoir d’eau en très mauvais état ; une place publique, ornée d’une croix, qu’ombragent deux beaux tilleuls; un oratoire érigé en 1769, renfermant une statue en bois de la Mère de Dieu, et 154h83a de pâtures, terres, murgers, friches et bois, d’un revenu cadastral de 1121 fr.
Bois communaux : 106h 59″ : coupe annuelle 3′ 13′. Budget : recettes ordinaires 1420 fr. – dépenses ordinaires 1394 fr. NOTICE HISTORIQUE
La voie gauloise d’Orgelet à Arinthod et à Isernore traversait le territoire de Nermier, dans la contrée dite à la Creuse : il n’est pas étonnant alors que la source du Bief d’Enfer, que le Creux de la Fondre et que les rochers aient été l’objet, dans ce village, d’un culte particulier. Le sol y est parsemé de médailles consulaires et impériales. Dans le lieu dit à la Sauge, près de la route d’Orgelet, sont trois tumulli parfaitement conservés. En ouvrant le chemin vicinal de Nermier à Sarrogna, on a trouvé, en 1853, deux tombeaux burgondes en maçonnerie et plus de vingt squelettes inhumés sans tombeaux. On avait déjà découvert, en 1815, deux autres tombeaux dans le champ du Crozet, où avait existé, dit-on, un couvent, tradition qui indiquerait l’emplacement d’une construction romaine. Le nom de Nermier se rencontre dans les titres de la chartreuse de Vaucluse dès la fin du XII’ siècle.
Seigneurie : Nermier formait une seigneurie particulière en moyenne et basse justice qui appartenait à la chartreuse de Vaucluse, et dépendait, pour la haute justice, de la baronnie d’Orgelet. Les sujets étaient tenus de faire le guet et garde au château de ce dernier lieu. Le meix Chalamont composait exactement le tiers de la seigneurie. Ponce II, sire de Cuisel, l’avait donné à la chartreuse pour augmenter sa dotation ; mais lorsque le prieur voulut en prendre possession, il rencontra une résistance à laquelle il ne s’attendait pas. Guillaume Boquers le tenait à titre d’engagère, in vadimonium, et persistait à en conserver la jouissance. Le donateur fut obligé d’intervenir, en 1226, pour apaiser son vassal. En 1233, Guillaume de Rosa), (di Rosellon) et Pierre, son fils, donnèrent à la chartreuse tous leurs droits sur les terrains qui se trouvaient entre Sarrogna et Nermier, et Pierre reconnut tenir en fief le meix de Chalamont. Pour prix de ces concessions, ils reçurent des religieux une somme de 70 livres, deux boeufs et la promesse qu’à leur mort on célébrerait leur office comme pour un des moines.
Le 4 des ides d’octobre 1255, G…, prieur de Gigny, et A…, prieur de Vaucluse, attestèrent que Jean, sire de Marigna, fils de Jean de Chalon, comte de Bourgogne, avait vendu, du consentement de B…, son épouse, et de ses deux fils Hugues et Jean, à H…, abbé de Saint-Oyan, et à son église, le tiers du village et du territoire de Nermier, en hommes, terres, bois, cours d’eau et justice, qu’il tenait en fief de ce monastère, moyennant une somme de 90 livres estevenantes.
Au mois d’avril 1287, Nicolin d’Écrilles, damoiseau, rongé par des emprunts usuraires, engagea aux chartreux, pour une somme de 120 livres, le meix Chalamont, consistant en terres, prés, bois, parcours, communaux, cours d’eau, tailles, services, amendes et juridiction, que ses ancêtres et lui-même avaient tenu d’eux en fief, et leur en céda la jouissance jusqu’à remboursement de cette somme. Guillemette, sa femme, et Jean, son fils, donnèrent leur adhésion à cet engagement en présence de Simon de Montbéliard seigneur de Montrond et de Cuiseau, et de Catherine, son épouse, qui apposèrent leurs sceaux. Huguenin, damoiseau, fils de Pierre, sire d’Écrilles, chevalier, ratifia ce traité au mois de novembre 1288. Nicolin d’Écrilles eut la douleur de perdre, presque en même temps sa femme et son fils. Il se décida alors à embrasser l’état religieux Au mois de juillet 1292, il vendit définitivement aux moines de Vaucluse le meix Chalamont pour une somme de 120 livres, destinée à acquitter ses dettes et à condition qu’ils lui assureraient une prébende pendant sa vie dans leur maison. Changeant plus tard de résolution, il renonça à cette prébende moyennant une somme de 60 livres (juin 1301).
Les religieux de Saint-Oyan détestaient les pauvres chartreux, leurs voisins, et leur suscitaient chaque jour de nouvelles chicanes. Non seulement ils les ruinaient en frais, mais encore ils gageaient leur bétail, incarcéraient leurs bergers et soutinrent des luttes qui coûtèrent la vie à plusieurs personnes. L’abbé Etienne et le prieur Hugues reconnurent enfin les dangers de leur situation et convinrent du choix de deux arbitres pour terminer leurs différends. Bernard de Moirans, curé de Sarrogna, et Humbert d’Arinthod, clerc, réussirent à ramener la paix.
Par une transaction du mois de février 1302 (n. st.), l’abbé Etienne céda aux chartreux les deux tiers lui appartenant du village de Nermier, même le fief tenu par Nicolet, fils d’Henri de Boquers, et ce qu’il avait à Sarrogna, Villeneuve, la Vilette, Viremont et Fétigny, sauf le patronage de l’église de Sarrogna. Le prieur Hugues céda, de son côté, à l’abbé Etienne, tout ce que son couvent avait au-delà de l’Ain, du côté du bourg de Moirans, sauf les droits d’usage et de pâturage et à condition qu’aucune maison ne pourrait jamais être bâtie dans les prés ou les bois de Bonnans, depuis le sommet de la montagne jusqu’au bord de l’Ain, afin que rien ne troublât la pudeur et la solitude des habitants de la chartreuse.
Hugonin et Guionet, fils de feu Mgr Etienne, sire d’Écrilles, attaquèrent la vente faite par Nicolin d’Écrilles, leur oncle, sous prétexte que ce dernier tenait le meix de Chalamont en fief de leur père, et que par conséquent il n’avait pu l’aliéner sans le consentement de son suzerain. Sur l’avis de Jean, sire de Cuisel, ils abandonnèrent ce procès moyennant une somme de 35 livres de petits-tournois (octobre 1300). Nous ferons remarquer à cette occasion que, sous le règne de Philippe-le-Bel et de Philippe-le-Long, son fils, la monnaie tournoise était presque la seule qui circulât dans le diocèse de Besançon.
Ce n’est qu’au prix de sacrifices continuels que les chartreux parvinrent à assurer leur domination sur Nermier. Aux propriétaires obérés, ils prêtaient de l’argent moyennant une rente en blé et en avoine, assignée sur leurs meix ; à d’autres, ils payaient des sommes plus ou moins fortes. En se montrant trop exigeants envers leurs sujets, les moines irritèrent la population et se virent menacés d’une véritable insurrection. Un certain jour, les habitants se réunirent en grand secret et résolurent de ne plus payer le cens de 25 quartaux de blé qu’on leur réclamait, de ne plus faire de corvées et d’élire eux-mêmes leurs gardes. Les religieux firent gager leur bétail et saisir leurs récoltes. L’irritation était arrivée à son comble, lorsque noble Ethevenin de Viremont et Pierre de Chilly offrirent leur médiation et furent choisis pour juges en dernier ressort.
Par une sentence rendue le 2 août 1330, il fut décidé 1° que les habitants paieraient chaque année le cens de 25 quartaux de blé ; 2° qu’ils ne feraient que trois corvées par an ; 3° que les maisons qu’ils bâtiraient sur leurs meix avec le bois des religieux suivraient le sort de ces meix et ne pourraient être enlevées ; 4° qu’ils pourraient vendre leurs propriétés, mais que dans ce cas les religieux pourraient exercer le droit de retenue avec un rabais du treizième du prix ; 5° qu’ils éliraient eux-mêmes leurs gardes ; 6° qu’on leur délivrerait du bois pour faire leurs charrues et leurs voitures ; enfin «que toute rancune, ou malice et discorde, cesseraient de suite.» On peut regarder cette transaction comme une véritable charte d’affranchissement.
Le mardi après Pâques 1333, Perrin, prévôt de Nermier, et son épouse, cédèrent aux chartreux la prévôté et la blérie de ce village avec le fief qui y était attache, consistant en maisons, prés et forêts, cours d’eau, pâturages, usage dans les bois et sur les communaux. Louis d’Ecrilles, sire de Marangea, et Guillaume, sire d’Écrilles, voulant empêcher les grangers de la chartreuse de mener pâturer leur bétail dans l’étendue de leurs seigneuries, se livrèrent à des voies de fait d’une haute gravité. Revenus à de meilleurs sentiments, ils avouèrent leurs torts en présence de Pierre de la Tour-du-Meix, et reconnurent qu’ils ne pouvaient empêcher la vaine pâture sur leurs terres.
Les autres événements concernant Nermier seront rapportés aux articles Onoz et Orgelet.
Maladrerie : Dans le lieu dit à la Malatière existait un hospice pour les lépreux, qui est détruit depuis longtemps.
Marangea
Extrait du Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté de A. ROUSSET
Tome IV (1854)
Village de l’arrondissement de Lons-le-Saunier, canton, perception et bureau de poste d’Orgelet ; paroisse de Sarrogna ; à 3 km de Sarrogna, 5 d’Orgelet et 24 de Lons-le-Saunier. Altitude : 478m.
Le territoire est limité au nord et à l’est par Écrilles ; au sud par Nermier, et à l’ouest par Montjouvent et Nermier.
Il est traversé par la route départementale n° 9, d’Orgelet à Nantua et à Bourg ; par les chemins vicinaux tirant à Orgelet et à Montjouvent ; par le bief de la Tuffière, qui y prend sa source, et par le bief sous la Ville, qui prend sa source à Nermier, sous le nom de bief ou ruisseau de la fontaine de Nermier. Le bief d’Enfer sépare sur une grande longueur Marangea d’Écrilles.
Le village est situé au fond d’une vallée. Les maisons sont groupées, construites en pierre et couvertes en tuiles plates, creuses ou en chaume. Elles ne se composent que d’un rez-de- chaussée.
Population : en 1790, 93 habitants ; en 1846, 112 ; en 1851, 99, dont 44 hommes et 47 femmes ; population spécifique par km carré, 37 habitants ; 23 maisons ; 23 ménages.
État civil : Les plus anciens registres datent de 1793.
Vocable : Assomption de Notre-Dame. Paroisse de Sarrogna.
Série communale à la mairie. La série du greffe, déposée aux Archives Départementales a reçu les cotes 3 E 5044 à 5047, 3 E 8115, 3 E 9855 à 9857 et 3 E 13023. Tables décennales : 3 E 1283 à 1291.
Microfilmé sous les cotes 5 Mi 646 et 647, 5 Mi 1254, 2 Mi 1088, 2 Mi 1805 et 1806.
Les jeunes gens émigrent, pour être ouvriers ou domestiques à Lyon et à Paris.
Cadastre : exécuté en 1827 ; surface territoriale 263h 22a, divisés en 705 parcelles que possèdent 90 propriétaires, dont 50 forains ; surface imposable 259h savoir : 841a en terres labourables, 74 en bois-taillis, 42 en prés, 3 en friches et murgers, 55a en pâtures et 24a en broussailles, d’un revenu cadastral de 4367 fr.; contributions directes en principal 457 fr.
Le sol, très accidenté, ne rend que trois fois et demie la semence, et produit du blé, de l’orge, de l’avoine, du maïs, des légumes secs, des betteraves, des pommes de terre, du chanvre, du lin, des fruits, du foin et des fourrages artificiels. On importe le tiers des céréales et le vin. Le revenu réel des propriétés est de 3 fr. 73 c. pour cent.
NOTICE HISTORIQUE
La vallée au fond de laquelle se cachent Écrilles et Marangea est trop près de la ville d’Orgelet pour n’avoir pas été habitée de bonne heure. On a trouvé à Écrilles, un petit bélier en bronze, d’un travail grossier, et à Marangea, des ouvriers, en remuant un terrain, appelé sur le Montet, ont découvert en 1842, plusieurs tombeaux en maçonnerie recouverts de dalles, qui renfermaient des ossements humains.
Seigneurie : Marangea était un fief dépendant de la seigneurie d’Écrilles. Les sujets étaient mainmortables et soumis à de nombreux droits seigneuriaux. Ils devaient l’impôt des quatre cas, une poule par ménage, quatre corvées par an, une gerbe de froment pour droit de sergenterie, autant pour droit de messerie, des cens en argent et en grains affectés sur leurs meix et maisons, et la dixième gerbe de tous les blés récoltés sur les terrains communaux qu’ils cultivaient. Ils ne pouvaient extraire du tuf dans la tuffière pour le vendre, sans payer deux liards par voiture. Il leur était défendu de couper du bois pour leur usage ailleurs que dans la forêt qui était sous la tuffière. Ils devaient réparer le moulin et le battoir, y moudre leurs grains et battre leur chanvre.
Ils intentèrent deux procès au parlement en 1687 et en 1758, pour faire reconnaître que leur territoire avait été affranchi de la main-morte, mais leurs prétentions furent toujours repoussées.
Seigneurs : Le 20 septembre 1488, Marguerite de la Baume, dite d’Aubonne, dame de Marangea, et Jean de Bouze, son mari, vendirent à noble Philibert de Roche, écuyer, seigneur de Montjouvent, et à Huguette de Monjouvent, son épouse, le village de Marangea, avec les hommes, les femmes, les rentes, les cens, les revenus, le moulin, le battoir, les cours d’eau, la justice, les bois, les terres et autres dépendances de ce domaine, moyennant 800 fr. Lorsque les acquéreurs présentèrent leur titre à l’approbation de Simone d’Oiselay, darne d’Écrilles, leur suzeraine, cette dernière répondit qu’elle entendait user du droit de retrait féodal et offrit aussitôt de leur rembourser le prix qu’ils avaient payé. Philibert de Roche refusa. Une procédure s’engagea à cette occasion au bailliage de Montmorot. Par une sentence du 10 septembre 1491, Jean Barillet, écuyer, seigneur de Légna, lieutenant du bailli d’Aval au siège d’Orgelet, accorda gain de cause à Simone d’Oiselay. Dès ce moment, Marangea n’a plus été séparé d’Écrilles.
Fiefs : En 1258, Jean, sire de Cuiseaux, reçut l’hommage de ce que Pierre de Roussillon, chevalier, tenait de lui en fief à Écrilles, Marangea et Virechâtel. Au mois de septembre 1296, Guy de Chilly, chevalier, et Guye, épouse de Jean de La Marche, firent hommage à Jean de Chalon, comte d’Auxerre et seigneur d’Orgelet, de tout ce qu’ils possédaient à Marangea et à Merlia.
Evénements divers : Marangea ressentit le contre-coup de tous les sièges dont Orgelet fut victime. Ce village fut entièrement détruit par les troupes de Louis XI, en 1479. L’emplacement des habitations ruinées s’appelle aux Murgers et aux Chaseaux.
Paroisse : Marangea dépendait, avant la révolution , de la paroisse d’Orgelet. Ce village a pour patron saint Pancras.
Curiosités naturelles : Dans le flanc de la montagne dite sur le Mont, est une grotte connue sous le nom de la Balme ou de la Bazune. Sa largeur à l’orifice est de 20 pieds et dans l’intérieur de 54. Sa profondeur est de plus de 300 pieds. L’obscurité qui y règne, ne permet de la visiter qu’à l’aide de flambeaux. « Il y a dans sa vaste capacité, dit le P. Joly, des antres ténébreux, capables d’intimider les plus hardis ; mais ce qui réjouit, c’est une fontaine dont l’eau est excellente. On sait par tradition, que pendant les guerres de 1636 à 1674 , cette caverne servait de retraite à plusieurs familles d’Orgelet, lesquelles avaient de là, la triste perspective de l’incendie de leur ville. »
Le rocher appelé la Tuffière, est tellement percé de grottes, qu’il ressemble à une éponge colossale. Contre ce rocher, se précipite avec fracas le bief de la Tuffière, qui prend sa source au sommet de la montagne.
Montjouvent
Extrait du Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté de A. ROUSSET
Tome IV (1854)
Mont-Jouvent, Montgevand, Montjouans,
Village de l’arrondissement de Lons-le-Saunier, canton, perception et bureau de poste d’Orgelet, paroisse de Sarrogna, à 3 km de Sarrogna, 4 d’Orgelet et 23 de Lons-le-Saunier en passant par Montaigu.
Altitude : 502m.
Le territoire est limité au nord par Orgelet et Plaisia, au sud par Chambéria, à l’est par la route d’Orgelet à Arinthod, Marangea, Plaisia et Nermier, à l’ouest par Orgelet et Chambéria. Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Nermier, Sarrogna et Orgelet ; par le ruisseau du Bourbouillon, la fontaine d’Argent et la fontaine du Chevalier.
Le village est situé sur la crête d’une colline, entre la route départementale n° 9, d’Orgelet à Nantua, et le chemin de grande communication n° 32, d’Orgelet à Arinthod. Les maisons sont disposées par groupes, construites en pierres et couvertes en chaume, sauf quelques-unes couvertes en tuiles ou en laves.
Population : en 1790, 143 habitants ; en 1846, 129 ; en 1851,146 dont 67 hommes et 79 femmes ; population spécifique par km carré, 42 habitants ; 32 maisons ; 32 ménages.
État civil : Les plus anciens registres de l’état civil datent de 1792.
Série communale à la mairie. La série du greffe, déposée aux Archives Départementales, a reçu les cotes 3 E 5449 à 5452, 3 E 8116, 3 E 9864 à 9866 et 3 E 13032.
Tables décennales : 3 E 1092 à 1100.
Microfilmé sous les cotes 5 Mi 734, 5 Mi 1273, 2 Mi 1106, 2 Mi 1825, 5 Mi 5 et 5 Mi 1183.
Vocable : saint Pancrace. Paroisse de Sarrogna.
Cadastre : exécuté en 1826 ; surface territoriale 3441′ 66″ divisés en 1128 parcelles que possèdent 64 propriétaires dont 18 forains ; surface imposable 341h à savoir: 141h en terres labourables, 78h en pâtures , 77h en bois-taillis, 33h en prés, 51h 56a en friches et murgers, 4h65a en broussailles, 92a en sol de bâtiments et 61a en jardins, d’un revenu cadastral de 4823 fr. ; contributions directes en principal 628 fr.
Le sol, montagneux, et d’une fertilité ordinaire, rend cinq fois la semence des céréales et produit du blé, beaucoup de maïs, des légumes secs, des carottes fourragères, des pommes de terre, du chanvre, du foin, un peu d’orge, d’avoine, de navette, de betteraves et de fourrages artificiels. On exporte le sixième des céréales et on importe le vin. Le revenu réel des propriétés est de 3 fr. 50 c. pour 0/0.
On élève dans la commune du beau bétail à cornes et des porcs qu’on engraisse, des mulets, des moutons et des volailles ; 40 ruches d’abeilles. L’agriculture y fait beaucoup de progrès.
On trouve sur le territoire de la marne, de la pierre à chaux, de la pierre ordinaire à bâtir et de la terre glaise propre à faire de la tuile et des briques.
Les habitants fréquentent habituellement les marchés d’Orgelet. Leur principale ressource consiste dans l’agriculture et l’éducation du bétail. Ils sont généralement dans l’aisance.
Biens communaux : quatre fontaines avec lavoirs et abreuvoirs un oratoire dédié à la Vierge, entre la forêt de Montjouvent et Orgelet, reconstruit en 1825 et placé dans le lieu dit à la Chapelle ; enfin 13e 72″ de pâtures et bois-taillis, d’un revenu cadastral de 981 fr. Il n’y a ni maison commune, ni école ; les enfants, au nombre de 30 garçons et 17 filles, fréquentent les écoles de Sarrogna et de Nermier.
Bois communaux : 531h 81&; coupe annuelle 61&. Budget : recettes ordinaires 1179 fr. ; dépenses ordinaires 1179 fr.
NOTICE HISTORIQUE
De quelque côté qu’on dirige ses pas autour d’Orgelet, on est sûr de rencontrer de précieux souvenirs des temps passés. Le culte druidique y a laissé surtout de profondes empreintes. A Montjouvent, les superstitions populaires ont eu longtemps beaucoup d’empire sur l’esprit des habitants. 11 y a peu d’années encore ils croyaient à l’existence et au pouvoir des loups-garous, des sorciers et des fées. Celles-ci se montraient, selon eux, sous la figure de vieilles femmes et à la pâle lueur de la lune qui relevait encore la blancheur éblouissante de leurs robes ; on les rencontrait près des fontaines ou sur le mont de la Fâ, presque toujours au nombre de trois, comme les sorcières de Macbeth. Ce nom deinont de la Fâ a puisé sa source dans des traditions celtiques.
Près de Saintes est un célèbre tumulus gaulois encore appelé la montagne de la Fée, Podium de Rida. La dénomination de Montjouvent, Mons Jovis, de Bois de Jou, paraît constater le culte rendu en ce lieu à Jupiter. Mille idées absurdes circulaient jadis sur la fontaine d’Argent qui se trouve au pied du mont de la Fâ. Les gens du pays croyaient qu’elle recelait une mine inépuisable de ce métal précieux, et plus d’une fois on les a surpris fouillant le sol pour en tirer des trésors imaginaires. Ce village offre de nombreux monuments de la période romaine. Au sud-ouest des habitations, dans le lieu dit au Buisson de on retrouve plusieurs substructions, des caves bien conservées, des amas de tuileaux à rebords et d’autres débris romains. Les habitants ne manquent pas de dire que ces ruines sont les restes d’une abbaye.
Un château fort, construit en grosses pierres et couvert en laves, recouvrait le plateau d’une montagne qui se trouve au nord-est de Montjouvent. On en reconnaît encore l’emplacement et le fossé taillé dans le roc vif. Les débris de cette vaste construction sont appelés les Fours Sarrasins. Dans le Roussillon, on attribue aux Maures toutes les tours de vigie qu’on remarque au sommet des montagnes. Dans le Lyonnais, les ruines de la ville de Mediolanum, Moingd, près de Montbrison, sont appelées par le peuple murs des Sarrasins. Celles de Novioregum, près de Saintes, ont la même dénomination. Nous pourrions démontrer par une foule d’exemples que les Maures n’ont pas laissé la trace d’un seul monument en France, et que le mot de Sarrasin sert généralement à désigner les monuments anciens, de quelque époque qu’ils soient. Au pied de cet ancien château, probablement d’origine romaine, passait un chemin tirant d’Orgelet à Arinthod et appelé aux Vies ou au Pérou. Les titres de la chartreuse de Vaucluse constatent l’existence de Montjouvent dès le XII’ siècle.
Seigneurie : Montjouvent formait une seigneurie en moyenne et basse justice, relevant pour la haute justice de celle d’Écrilles. Les sujets étaient mainmortables et soumis à beaucoup de corvées et autres charges féodales.
Seigneurs : La seigneurie de Montjouvent fut possédée, pendant plusieurs siècles, par une famille noble qui portait le nom de cette terre. Il est difficile de distinguer ces seigneurs de ceux qui possédaient en partie la seigneurie de Varennes-Saint-Sauveur. Jeanne de Montjouvent ou de Sainte-Croix était mariée, en 1475, à Guyot de Poligny, seigneur de Coges et d’Augea ; Claude de Montjouvent était allié, vers l’an 1520, à Jeanne de Mauffans. Il ne possédait plus, à cette époque, la terre dont il portait le nom. Elle était entre les mains de Philibert de Roche, qui la donna a Denise, sa fille, épouse de Philibert ;W.- de Grolée, chevalier, seigneur de Luys en Bugey. Cette terre se divisa en plusieurs parties.
En 1537, Jean, sire de Rupt, conseiller, chambellan de l’empereur Charles-Quint et chevalier en sa cour de parlement, en acheta quatre douzièmes et demi de Nicolas Vauchard, général des monnaies de Bourgogne, qui en était lui-même acquéreur. Il assigna aussitôt Philiberte de Saulx, veuve de Reynjer de Saubief, comme tutrice de Claude et Philibert de Saubief, ses fils, au partage de la seigneurie. On lui attribua, pour ses droits, un petit corps de bâtiment qui se trouvait à gauche de la porte d’entrée du château avec la tourelle à côté, deux chambres au nord du principal corps de bâtiment, avec la tour qui y était attenante, les fossés à l’entour et la partie des jardins et vergers joignant le grand chemin d’Orgelet. Le donjon, la porte, le pont-levis, la tour de l’escalier, la chapelle, le meix d’Entremont où étaient les grangeages, le colombier et tout le surplus du château furent réservés aux mineurs de Saubief. Le lot échu à Jean de Rupt passa par acquisition à Jean II de la Touvière, marié, le 23 août 1500, à Philiberte de Morel, dame d’Étrilles. Celui arrivé à MM. de Saubief fut acheté, en 1573, par Claude Lallemand, seigneur de Belmont, et revendu presque immédiatement à Claude de Binand, seigneur de Chambéria. Jean de la Touvière, du nom, seigneur d’Écrilles, fit des démarches inouïes pour être reconnu propriétaire exclusif du château de Montjouvent. Lorsque le duc d’Albe passa, avec son armée, à Orgelet, pour se rendre dans les Pays-Bas, au mois de juin 1567, Jean de la Touvière l’accompagna avec six chevaux et dépensa dans cette expédition des sommes considérables. Il fit plusieurs voyages à Bruxelles pour obtenir qu’à titre d’indemnité, le roi d’Espagne, comme seigneur d’Orgelet et suzerain d’Étrilles, reconnût que le château de Montjouvent devait lui appartenir à lui seul, en raison surtout des travaux importants qu’il y avait faits pour le mettre en bon état de défense. Louis de Binand, l’un des fils de Claude, eut ce domaine dans son lot et y fixa son séjour. Il testa le 28 avril 1603 et légua 300 fr. à Claudine, sa soeur, religieuse à Château-Chalon ; à Claude-Antoine et Louis de Binand, ses fils naturels, à chacun 800 fr., sa maison de Revigny et sa grange de Montjouvent, et institua pour son héritier universel Guillaume de Binand, son frère ; Pierre de Binand, l’un de ses autres frères, abbé de Baume, fut chargé de l’exécution de ses volontés.
En 1626, Guillaume de Binand, seigneur de Chambéria, donna sa portion de seigneurie de Montjouvent, en usufruit viager, à Jean-Antoine de Binand, son neveu illégitime, prieur de Chatonnay, qui fixa son séjour au château. Adrienne-Thérèse de Binand, sa fille unique, mariée, en 1650, à Jean-François de Joux, dit de Grimmont, baron de Châtillon-Guyotte, obtint, en 1700, de l’archevêque de Besançon, l’autorisation de faire célébrer les offices dans la chapelle qui était dans une des tours, parce que son âge ne lui permettait pas d’aller à l’église paroissiale. Cette dame chercha plusieurs fois à acheter les parts des seigneurs d’ Étrilles, mais ses négociations échouèrent.
Ce n’est qu’en 1712 que Gabriel-Philibert et François-Gaspard de Joux de Grammont, ses fils, purent terminer cette acquisition et rester seuls propriétaires de Montjouvent. Claude-Louis-Maximilien, libre baron d’Iselin de Lannans, en fut le dernier possesseur féodal comme héritier en partie de Gabrielle-Charlotte-Françoise-Gasparinc, fille de Gabriel-Philibert de Grammont. Ce seigneur ayant émigré, ses biens furent vendus nationalement.
Château : Il est situé à l’extrémité septentrionale du village et se composait d’un corps de bâtiment ayant la forme d’un parallélogramme rectangle de 20″‘ de côté sur 9 de large, précédé d’une cour close de murs. Le tout était entouré par un fossé de 151″ de largeur et de 41″ de profondeur, alimenté d’eau par des sources qui se trouvaient dans le voisinage. La façade postérieure était flanquée de deux tours circulaires de 5″‘ de diamètre. Au centre de la façade était une tour octogonale contenant l’escalier. Les angles de la cour étaient défendus par deux autres tours semblables à celles du bâtiment. La porte était précédée d’un pont-levis. De ces constructions il ne reste que deux tours, le bâtiment principal et les traces des fossés. Les ouvertures sont du style ogival tertiaire. Ce château, en mauvais état, appartient à Mlle Mélanie Buffet qui l’habite.